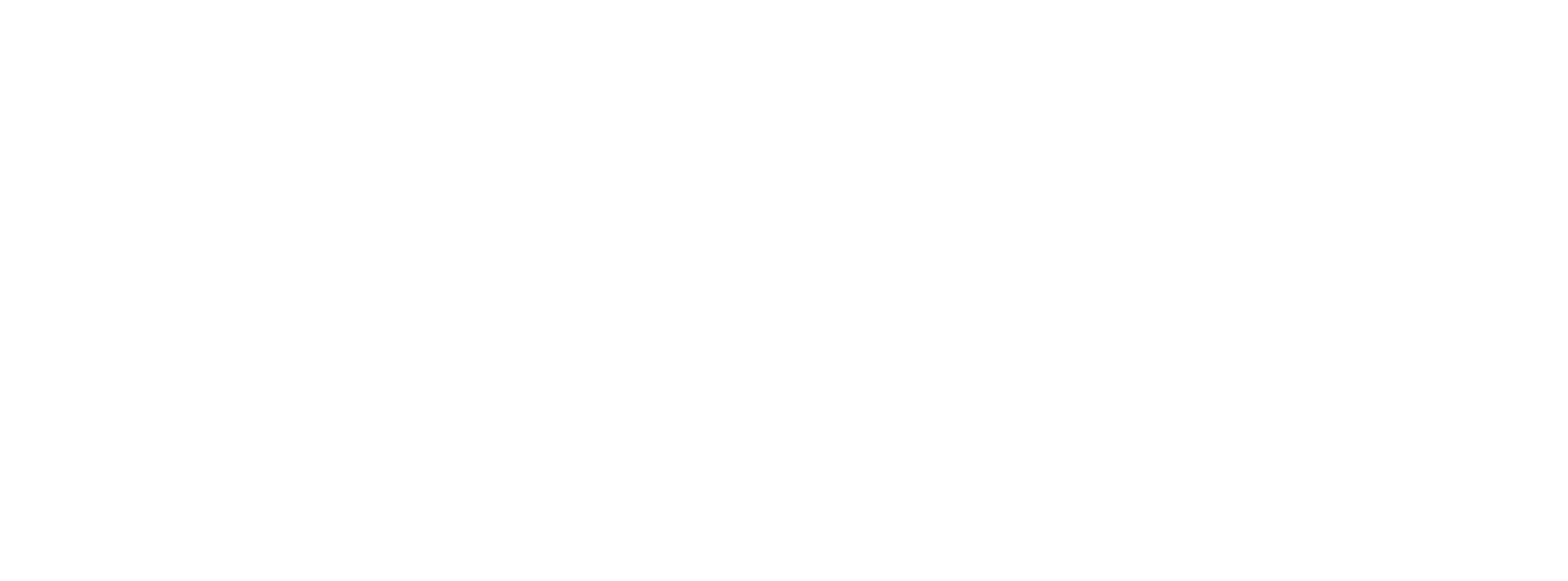VOIR L’ENSEMBLE DES ARTICLES
VOIR L’ENSEMBLE DES ARTICLES
 VOIR L’ENSEMBLE DES ARTICLES
VOIR L’ENSEMBLE DES ARTICLES

Au Québec, nous avons choisi il y a plus de 100 ans de miser sur la production d’aluminium, notamment en raison de notre réseau hydroélectrique unique au monde qui nous permet de nous démarquer avec la production d’un aluminium à très faible empreinte carbone et produit de façon responsable. Depuis, la demande ne cesse d’augmenter. La transition vers une économie décarbonée stimulera encore davantage la demande en aluminium dans les années à venir, particulièrement dans le secteur de l’automobile et de la production d’énergie renouvelable, notamment à partir d’éoliennes et de panneaux solaires, en plus des lignes de transmission à haute tension.
Aluminium et automobiles : une innovation qui marque l’histoire
Depuis 1970, la présence d’aluminium ne cesse de croître dans le secteur de l’automobile, particulièrement en raison de sa légèreté. Dans les dernières années, l’arrivée de la voiture électrique a décuplé les besoins. Le poids supplémentaire de la batterie crée la nécessité d’alléger les différentes composantes de la voiture, si bien qu’on retrouve maintenant plusieurs pièces en aluminium. C’est le cas de certains radiateurs, des roues et, depuis peu, des châssis de quelques voitures, notamment du Model S de Tesla et du Ford F-150.
« Le châssis en aluminium représente une innovation très importante. La création de cette technologie a débuté dans les années 1980 et nous voyons maintenant tout le succès de la recherche et du développement effectué. Si nous pouvons parcourir de si longues distances à bord de nos véhicules électriques avec une seule charge, c’est entre autres grâce à l’aluminium. »
– Nigel Steward, scientifique en chef chez Rio Tinto
Effectivement, les propriétés de l’aluminium en font un choix judicieux non seulement pour l’industrie de l’automobile, mais aussi pour l’aérospatiale et la transition énergétique.
- La densité de l’aluminium rend ce métal particulièrement léger, trois fois moins lourd que l’acier.
- Sa conductivité électrique est aussi idéale, notamment dans la fabrication de fils électriques.
- Les différents alliages possibles permettent d’augmenter la résistance de l’aluminium et d’en faire un matériau à la fois solide et léger. Pour l’Airbus A380, on utilise notamment un alliage d’aluminium et de lithium.
La transition énergétique : un défi et une opportunité pour l’industrie
Un des défis majeurs des prochaines années est la décarbonation de notre économie. Dans le monde entier, l’énergie provenant de la combustion des énergies fossiles devra être remplacée par une énergie provenant de sources renouvelables. En plus de décarboner la production d’électricité, il sera nécessaire d’augmenter les capacités de production pour subvenir aux besoins grandissants. L’aluminium, qu’on retrouve entre autres dans les panneaux solaires, les éoliennes et les lignes de transmissions, aura donc un rôle important à jouer. Conséquemment, sa production est appelée à croître rapidement.
Il y a des opportunités pour l’industrie, mais aussi des défis. Par exemple, bien que l’aluminium québécois ait une empreinte carbone six fois inférieure à la moyenne mondiale grâce à l’utilisation d’hydroélectricité, notre production d’aluminium primaire n’est pas encore carboneutre. Face à la lutte aux changements climatiques et à cette accélération de la demande, réussir cet exploit devient une priorité. « Nous sommes donc face à un double défi : décarboner notre industrie et augmenter le rythme de la production », ajoute Nigel Steward.
ELYSISMD : la clé pour atteindre nos objectifs
ELYSISMD, c’est la technologie de rupture qui fait rêver l’industrie québécoise de l’aluminium. Il s’agit d’un procédé révolutionnaire pour la production d’aluminium primaire qui permettrait de réduire à zéro les émissions de dioxyde de carbone (CO2). En 2018, les équipes de recherche d’Alcoa et Rio Tinto, ici au Québec, ont réussi à faire une preuve de concept, soit à démontrer scientifiquement que la technologie fonctionne. La prochaine étape est de faire l’essai technologique, c’est-à-dire l’ingénierie qui permettra à ELYSISMD d’être implantée dans un environnement industriel.
Nigel Steward précise : « c’est une étape qui est plus longue et qui exige beaucoup d’essais-erreur. À titre d’exemple, la preuve de concept des batteries pour véhicules électriques a été faite à la fin des années 1970, mais le premier produit a été commercialisé seulement en 1991, soit 21 ans plus tard. »
Il faudra donc être patient, mais les perspectives de carboneutralité sont enthousiasmantes. En plus de ses bénéfices environnementaux, le recours à la technologie ELYSISMD permettra aux alumineries de réaliser des améliorations en matière de santé et sécurité au travail, d’augmenter leur productivité et de réduire leurs coûts d’opération.
Recherche et développement : un travail d’équipe
Comme pour d’autres innovations réalisées par le passé, l’ensemble de l’industrie contribue activement au développement d’ELYSISMD : des équipes de recherche et développement des alumineries, des équipementiers, et des universités unissent leurs forces. L‘écosystème de l’aluminium au Québec est vaste et tous participent à l’évolution et l’optimisation des procédés.
Les alumineries entretiennent une relation étroite avec les équipes de recherche et les universités. Cette collaboration a permis de développer des innovations majeures qui ont positionné l’industrie québécoise sur la scène internationale. C’est notamment le cas de la création d’une technologie en partenariat avec l’Université du Québec à Chicoutimi qui permet de séparer les solides et les liquides dans la production d’alumine. Maintenant vendue partout à travers le monde, ce n’est qu’un des exemples de l’effervescence en matière d’innovation au Québec.
Bien qu’ELYSISMD soit sur toutes les lèvres, d’autres innovations occupent aussi les équipes de recherche, notamment la création d’alliages à la fois légers et résistants ou encore la robotisation des procédés et l’intégration de l’intelligence artificielle.